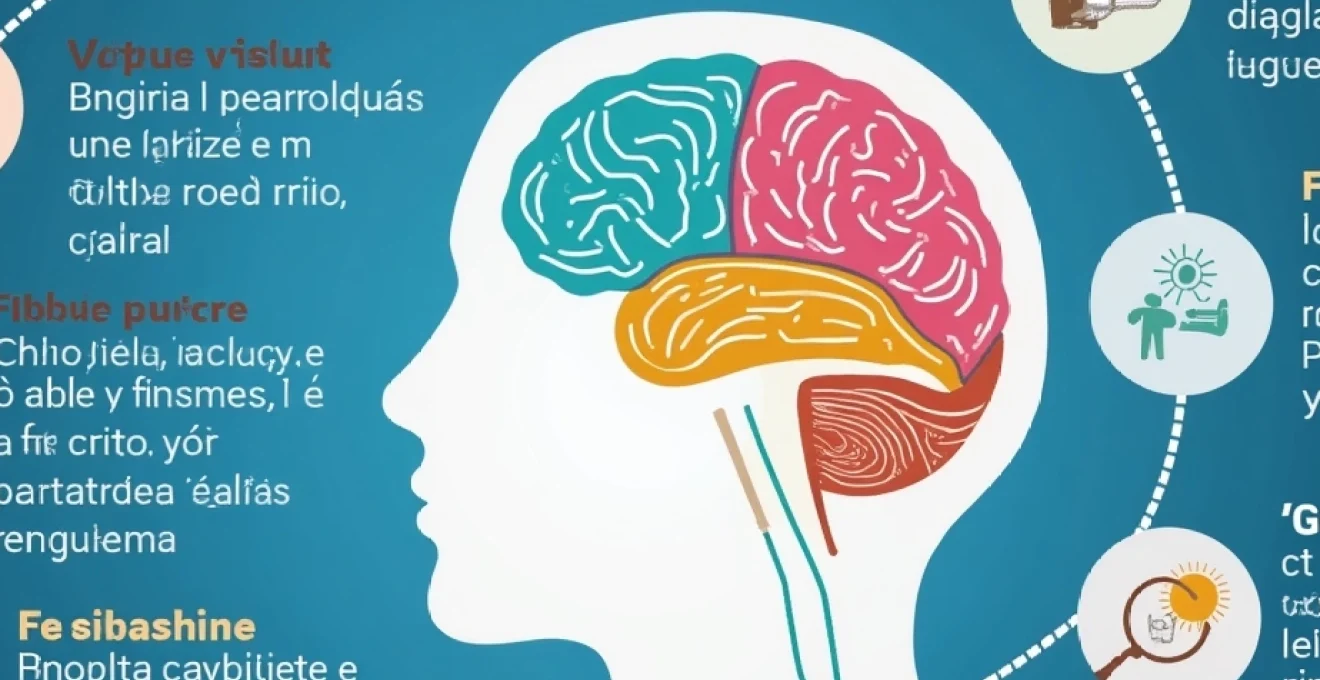
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique chronique complexe qui touche le système nerveux central. Son diagnostic précoce représente un défi majeur pour les professionnels de santé, car les symptômes peuvent être variés et parfois trompeurs. Identifier les signes évocateurs et connaître les facteurs de risque est essentiel pour orienter rapidement les patients vers une prise en charge adaptée. Cette pathologie auto-immune, qui affecte principalement les jeunes adultes, nécessite une vigilance particulière de la part des médecins généralistes et des neurologues.
Symptômes neurologiques évocateurs de la sclérose en plaques
La SEP se caractérise par une grande diversité de manifestations cliniques, reflétant la dissémination des lésions dans le système nerveux central. Certains symptômes sont particulièrement évocateurs et doivent alerter le praticien, surtout lorsqu’ils surviennent chez un sujet jeune.
Troubles visuels : névrite optique et diplopie
Les atteintes visuelles constituent souvent les premiers signes de la maladie. La névrite optique, caractérisée par une baisse de l’acuité visuelle unilatérale associée à une douleur à la mobilisation du globe oculaire, est un symptôme cardinal de la SEP . Elle touche environ 20% des patients au début de la maladie. La diplopie, ou vision double, peut également survenir et témoigne d’une atteinte des voies oculomotrices.
Il est important de noter que ces troubles visuels ont tendance à s’installer progressivement sur quelques heures ou jours, et non de manière brutale comme dans le cas d’un accident vasculaire cérébral. La récupération spontanée, souvent partielle, est fréquente après quelques semaines.
Paresthésies et troubles sensitifs fluctuants
Les troubles sensitifs sont fréquents dans la SEP et se manifestent par des paresthésies (fourmillements, engourdissements) ou des dysesthésies (sensations de brûlure, de serrement). Ces symptômes touchent typiquement un ou plusieurs membres, le tronc ou le visage. Leur caractère fluctuant et migratoire est évocateur de la maladie.
Un signe particulier, appelé signe de Lhermitte , peut être rapporté par les patients : il s’agit d’une sensation de décharge électrique parcourant la colonne vertébrale et les membres lors de la flexion du cou. Bien que non spécifique, ce symptôme est fortement suggestif d’une atteinte médullaire cervicale.
Fatigue intense et syndrome de lhermitte
La fatigue est un symptôme extrêmement fréquent dans la SEP, touchant jusqu’à 80% des patients. Elle se caractérise par son intensité inhabituelle, sa survenue brutale et son caractère invalidant. Cette asthénie n’est pas proportionnelle à l’effort fourni et peut considérablement altérer la qualité de vie des patients.
Le syndrome de Lhermitte, mentionné précédemment, mérite une attention particulière. Il s’agit d’une sensation de décharge électrique descendant le long de la colonne vertébrale lors de la flexion du cou. Ce signe, bien que non pathognomonique, est fortement évocateur d’une SEP lorsqu’il est associé à d’autres symptômes neurologiques.
La présence concomitante de troubles visuels, sensitifs et d’une fatigue intense chez un sujet jeune doit faire évoquer le diagnostic de sclérose en plaques et conduire à des investigations complémentaires.
Profil épidémiologique et facteurs de risque
La connaissance du profil épidémiologique de la SEP est cruciale pour cibler les populations à risque et optimiser le dépistage précoce de la maladie. Plusieurs facteurs démographiques et environnementaux ont été identifiés comme influençant le risque de développer une SEP.
Âge de survenue et prédominance féminine
La SEP est typiquement une maladie du jeune adulte, avec un pic d’incidence entre 20 et 40 ans. Les formes pédiatriques (avant 18 ans) et tardives (après 50 ans) existent mais sont plus rares. On observe une nette prédominance féminine, avec un sex-ratio d’environ 3 femmes pour 1 homme dans les formes rémittentes-récurrentes, qui représentent 85% des cas au début de la maladie.
Cette disparité entre les sexes tend à s’atténuer dans les formes progressives d’emblée, qui touchent des sujets plus âgés. L’âge moyen de début de la maladie est légèrement plus précoce chez les femmes (29 ans) que chez les hommes (31 ans).
Distribution géographique et gradient Nord-Sud
La répartition géographique de la SEP présente des particularités intéressantes. On observe un gradient de prévalence Nord-Sud dans l’hémisphère Nord, avec une fréquence plus élevée de la maladie dans les pays nordiques. Ce gradient s’inverse dans l’hémisphère Sud.
Ainsi, les régions de haute prévalence (plus de 30 cas pour 100 000 habitants) se situent principalement en Europe du Nord, au Canada et dans le nord des États-Unis. À l’inverse, les zones de basse prévalence (moins de 5 cas pour 100 000 habitants) se trouvent près de l’équateur.
Facteurs environnementaux : vitamine D et virus d’Epstein-Barr
Plusieurs facteurs environnementaux ont été associés à un risque accru de développer une SEP. Parmi eux, le déficit en vitamine D joue un rôle important. Cette carence, plus fréquente dans les régions moins ensoleillées, pourrait expliquer en partie le gradient Nord-Sud observé.
L’infection par le virus d’Epstein-Barr (EBV) est également considérée comme un facteur de risque majeur. En effet, près de 100% des patients atteints de SEP présentent des anticorps contre l’EBV, contre environ 90% dans la population générale. Une infection symptomatique par l’EBV (mononucléose infectieuse) augmente le risque de SEP d’un facteur 2 à 3.
L’association entre l’infection à EBV et le risque de SEP est si forte que certains chercheurs émettent l’hypothèse d’un rôle causal du virus dans le développement de la maladie.
Examens paracliniques pour le diagnostic différentiel
Face à une suspicion de SEP, plusieurs examens complémentaires sont indispensables pour confirmer le diagnostic et exclure d’autres pathologies. Ces investigations permettent de mettre en évidence la dissémination spatiale et temporelle des lésions, caractéristique de la maladie.
IRM cérébrale et médullaire : critères de Barkhof-Tintoré
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est l’examen de référence pour le diagnostic de la SEP. Elle permet de visualiser les lésions démyélinisantes caractéristiques de la maladie, appelées plaques . Les critères de Barkhof-Tintoré, largement utilisés, définissent les caractéristiques IRM évocatrices de SEP :
- Au moins 3 des 4 critères suivants doivent être présents :
- Au moins 1 lésion rehaussée par le gadolinium ou 9 lésions T2 hyperintenses
- Au moins 1 lésion sous-tentorielle
- Au moins 1 lésion juxta-corticale
- Au moins 3 lésions périventriculaires
L’IRM médullaire est également importante, car elle peut révéler des lésions non visibles à l’IRM cérébrale, notamment dans les formes progressives. La présence de lésions médullaires étendues sur plus de trois segments vertébraux doit faire évoquer d’autres diagnostics, comme la neuromyélite optique de Devic.
Ponction lombaire et recherche de bandes oligoclonales
L’analyse du liquide céphalo-rachidien (LCR) par ponction lombaire est un élément clé du diagnostic. La recherche de bandes oligoclonales est particulièrement importante. Ces bandes, présentes dans le LCR mais absentes du sérum, témoignent d’une synthèse intrathécale d’immunoglobulines et sont retrouvées chez environ 95% des patients atteints de SEP.
D’autres anomalies du LCR peuvent être observées, comme une légère pléiocytose (moins de 50 cellules/mm³) à prédominance lymphocytaire ou une élévation modérée de la protéinorachie. L’absence de bandes oligoclonales n’exclut pas le diagnostic de SEP, mais doit faire envisager d’autres hypothèses diagnostiques.
Potentiels évoqués visuels et somesthésiques
Les potentiels évoqués (PE) permettent de mettre en évidence des lésions cliniquement silencieuses du système nerveux central. Les PE visuels sont particulièrement utiles pour détecter une atteinte infraclinique du nerf optique. Un allongement du temps de latence de l’onde P100 est évocateur d’une démyélinisation du nerf optique, même en l’absence de symptômes visuels.
Les PE somesthésiques peuvent révéler des lésions des voies sensitives médullaires ou cérébrales. Bien que moins utilisés depuis l’avènement de l’IRM, les PE conservent un intérêt dans certaines situations cliniques, notamment pour objectiver une atteinte fonctionnelle non visible en imagerie.
Formes cliniques et évolution de la sclérose en plaques
La SEP se caractérise par une grande variabilité dans son expression clinique et son évolution. La reconnaissance des différentes formes de la maladie est essentielle pour adapter la prise en charge et le suivi des patients.
Syndrome cliniquement isolé (CIS) et syndrome radiologiquement isolé (RIS)
Le syndrome cliniquement isolé (CIS) correspond à un premier épisode de symptômes neurologiques évocateurs de SEP, mais ne remplissant pas encore les critères diagnostiques de dissémination spatiale et temporelle. Environ 60 à 80% des patients présentant un CIS évolueront vers une SEP cliniquement définie dans les années suivantes.
Le syndrome radiologiquement isolé (RIS) désigne la découverte fortuite de lésions évocatrices de SEP à l’IRM chez un patient asymptomatique. Le risque de conversion vers une SEP clinique est d’environ 30% à 5 ans. La prise en charge de ces patients fait l’objet de débats, certains préconisant une surveillance rapprochée, d’autres envisageant un traitement précoce dans certains cas à haut risque.
Formes rémittentes-récurrentes et secondairement progressives
La forme rémittente-récurrente est la plus fréquente au début de la maladie, touchant environ 85% des patients. Elle se caractérise par la survenue de poussées suivies de phases de rémission plus ou moins complètes. Avec le temps, environ 50% des patients évolueront vers une forme secondairement progressive, marquée par une aggravation progressive des symptômes indépendamment des poussées.
La forme progressive d’emblée, qui concerne environ 15% des patients, se distingue par une aggravation continue des symptômes dès le début de la maladie, sans poussées distinctes. Cette forme touche généralement des patients plus âgés et présente un pronostic moins favorable.
| Forme de SEP | Caractéristiques principales | Fréquence |
|---|---|---|
| Rémittente-récurrente | Poussées suivies de rémissions | 85% au début |
| Secondairement progressive | Aggravation progressive après une phase rémittente | 50% après 10-20 ans |
| Progressive d’emblée | Aggravation continue sans poussées distinctes | 15% au début |
Diagnostic différentiel et pathologies à éliminer
Le diagnostic de SEP repose sur un faisceau d’arguments cliniques et paracliniques. Cependant, d’autres pathologies peuvent présenter des manifestations similaires et doivent être soigneusement écartées avant de poser le diagnostic définitif.
Neuromyélite optique de devic et anticorps anti-AQP4
La neuromyélite optique de Devic (NMO) est une pathologie inflammatoire du système nerveux central qui peut être confondue avec la SEP. Elle se caractérise par des atteintes sévères du nerf optique et de la moelle épinière. La découverte des anticorps anti-aquaporine 4 (anti-AQP4) a permis de mieux distinguer la NMO de la SEP.
Les critères distinctifs de la NMO incluent :
- Des lésions médullaires étendues sur plus de trois segments vertébraux
- Une atteinte bilatérale et sévère du nerf optique
- La présence d’anticorps anti-AQP4 dans le sérum
- L’absence de lésions cérébrales typiques de la SEP à l’IRM
Le diagnostic différentiel entre SEP et NMO est crucial car les traitements diffèrent et certains médicaments utilisés dans la SEP peuvent aggraver la NMO.
Leucoencéphalopathies vasculaires et maladie de binswanger
La leucoencéphalopathie vasculaire, notamment la maladie de Binswanger, peut parfois être confondue avec la SEP, en particulier chez les patients plus âgés. Cette pathologie se caractérise par des lésions de la substance blanche d’origine vasculaire, visibles à l’IRM. Les éléments distinctifs incluent :
- Une distribution périventriculaire et sous-corticale des lésions
- La présence de facteurs de risque vasculaires (hypertension, diabète)
- Une évolution progressive sans poussées
- L’absence de rehaussement des lésions après injection de gadolinium
L’âge plus avancé des patients et l’absence de dissémination temporelle des lésions sont des arguments en faveur d’une leucoencéphalopathie vasculaire plutôt que d’une SEP.
Maladies inflammatoires systémiques : lupus et syndrome de sjögren
Certaines maladies auto-immunes systémiques peuvent avoir des manifestations neurologiques similaires à celles de la SEP. Le lupus érythémateux disséminé (LED) et le syndrome de Sjögren sont particulièrement concernés.
Dans le cas du LED, les atteintes neurologiques peuvent inclure des troubles cognitifs, des convulsions, ou des neuropathies périphériques. L’IRM peut montrer des lésions de la substance blanche ressemblant à celles de la SEP. Cependant, la présence d’autres manifestations systémiques (atteintes cutanées, articulaires, rénales) et la positivité des anticorps anti-nucléaires orientent vers le diagnostic de LED.
Le syndrome de Sjögren peut également provoquer des lésions cérébrales évocatrices de SEP. La distinction repose sur la présence de symptômes caractéristiques comme la sécheresse oculaire et buccale, ainsi que sur la positivité des anticorps anti-SSA et anti-SSB.
Il est crucial de rechercher systématiquement des signes extra-neurologiques et de réaliser un bilan immunologique complet devant toute suspicion de SEP, afin d’éliminer ces pathologies systémiques qui peuvent la mimer.
En conclusion, le diagnostic de sclérose en plaques repose sur un faisceau d’arguments cliniques, radiologiques et biologiques. La vigilance du praticien face aux symptômes évocateurs, associée à une connaissance approfondie des diagnostics différentiels, permet une prise en charge précoce et adaptée des patients. L’évolution des critères diagnostiques et des techniques d’imagerie contribue à améliorer la précision du diagnostic, ouvrant la voie à des traitements plus ciblés et efficaces.
